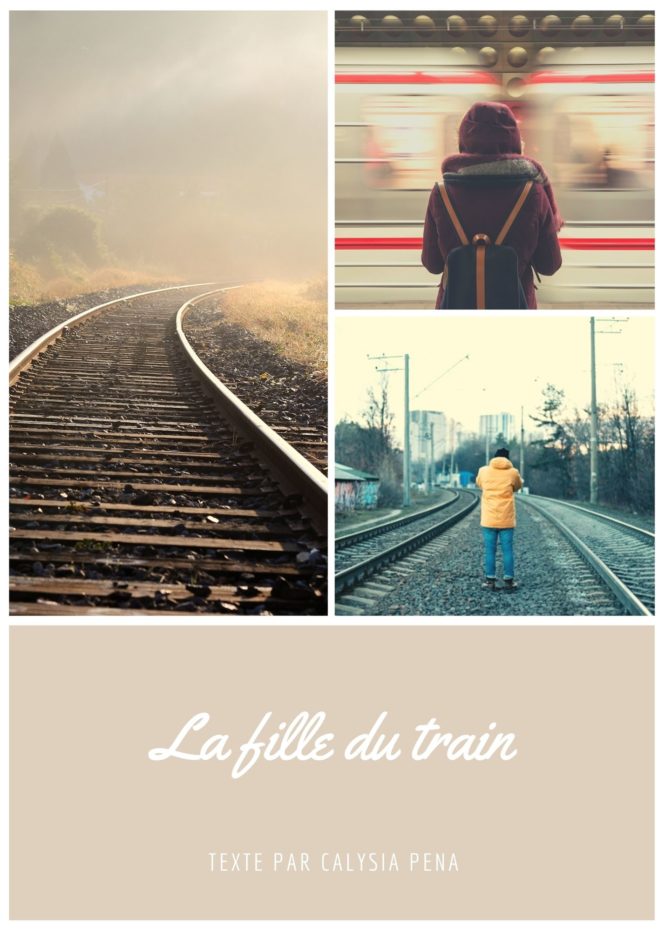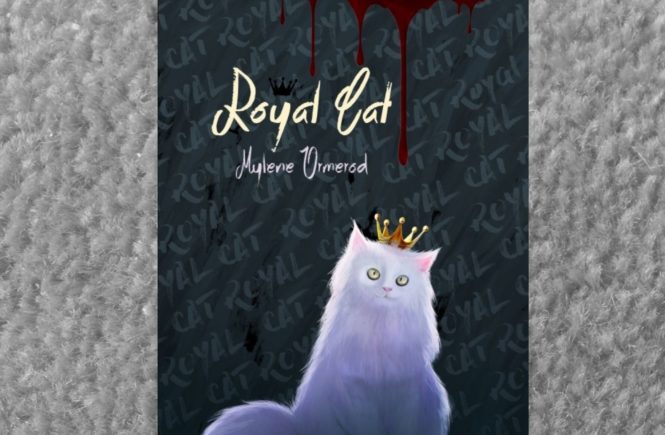Elle était assise sur la banquette du train régional, de 19 h 34, qu’elle prenait chaque soir de la semaine. Tout comme moi, elle rentrait chez elle, après sa journée de travail. Elle était, comme chaque jour, assise à la même place, sur la banquette orange à trois places, celle juste après la porte vitrée. Elle s’était assise contre la fenêtre, et avait posé le coude contre le rebord de couleur beige, attendant que le train quitte le terminus pour se rendre à celui situé à l’opposé.
Grâce à elle, le trajet m’était devenu moins gris, parmi cette foule d’anonymes avec qui je partageais, en silence, ce wagon, depuis tant de mois. Ce même trajet, aujourd’hui, était devenu à mes yeux, bien trop court, et cela grâce à sa seule présence. Je passais les minutes, qui me semblaient des secondes, à la regarder, en la dévorant presque de mes yeux, à défaut de pouvoir la dévorer de mes lèvres avides.
Dans sa main, comme tous les soirs, elle tenait un stylo à encre bleue, qu’elle ne cessait de faire couler sur son carnet à couverture bleu et à petits carreaux. Je pensais souvent qu’elle devait aimer le bleu, sans doute pour l’immensité de ses teintes, pour en avoir fait si souvent son compagnon le plus fidèle d’écriture.
Au travers de cette encre, je découvrais l’immensité de la mer et l’infini du ciel sous lequel elle vivait, sans que je la sache, depuis des années, à mes côtés et qui me donnait envie de m’évader. J’aurais tellement voulu voir le fond de ses yeux, afin de lire le fond de son cœur. Je voulais regarder autre chose que ces carreaux sales, à travers lesquels je ne voyais que la grisaille du monde amer et qui m’isolait loin d’elle. Son reflet se dessinait devant moi, comme un mirage en plein sahara, et elle devenait irréelle, intouchable et filait, sous mon regard, à la vitesse du paysage que le train croisait.
J’aurais voulu lui prendre la main sur une plage au soleil couchant, entrelacer ses doigts aux miens, comme pour mieux lier nos cœurs, l’un à l’autre. En fermant les yeux, je l’imaginais dans mes bras regardant les vagues agitées de l’océan et le ciel embrasser l’eau de ses couleurs vives aux teintes qui se faisaient nuit. Je voulais l’allonger sur ce sable fin et sentir sa peau chaleureuse qui sentirait les saveurs fruitées de l’été.
Mais les agitations de la machine et les conversations des passagers du train me ramenaient au présent où elle n’était rien d’autre qu’un songe intouchable. Dans cette réalité, elle était cette fille du train qui ne me voyait pas et pour qui, je n’existais pas. Je semblais être l’homme invisible à ses yeux, alors que dans les miens elle brillait de milliers de couleurs, telle une voûte étoilée que traversait un arc-en-ciel.
De temps à autre, elle relevait la tête de son carnet, comme on sort d’un long et profond sommeil. Ses yeux étaient gonflés et son visage semblait chercher un point qu’elle aurait pu reconnaître afin de se remémorer l’endroit où elle se trouvait. Alors, quand elle surgissait de ses rêves bleutés, elle regardait par la fenêtre, pour reprendre son souffle comme après une course folle. Celle que ses doigts venaient d’achever sur le papier ou celui de son esprit qui ne cessait de lui dicter ses mots à toute vitesse. Les cheveux en bataille, elle plongeait ses yeux vers l’horizon l’éloignant davantage encore de moi.
Le paysage rural, alors, défilait devant ses yeux. Il était devenu notre quotidien, soir après soir. Il me semblait qu’elle le découvrait, à chaque fois, pour la première fois, comme un enfant qui découvre un jouet le soir de Noël, avec un regard rempli de surprise. Elle avait ce don, qui me faisait découvrir le monde, et à travers ses yeux, il me paraissait moins sombre.
Elle regardait cette nature qui défilait devant nos yeux, des siens, elle soulignait chaque espace et chaque forme qu’elle croisait. Et moi du coin de l’oeil, je dévorais les siennes, à défaut de ne pouvoir le faire de mes mains. Elle était si belle quand elle avait ce regard de découverte, tel un conquistador débarquant sur un nouveau continent. Elle avait, sur le monde, ce regard d’enfant, si nouveau et si innocent. Puis elle croisait mon regard sur la vitre, rougissait comme si elle avait été impudique de m’avoir frôlée.
Puis, elle replongeait de nouveau dans son carnet, s’enfermant dans son univers fait de mots. Elle se barricadait dans un monde, où derrière elle, elle fermait la porte à double tour. Un endroit dans lequel, je n’existais pas et où elle ne savait pas que je respirais, de loin, la douce odeur musquée de son parfum. Elle ne savait pas que j’attendais à sa porte. Je voulais qu’elle sorte de derrière ses murs qui m’empêchaient de partager avec elle des moments, où son stylo laisserait place à sa voix. Elle ne me voyait pas assis là à côté d’elle avec le seul espoir qu’elle me regarde enfin. Elle ne me voyait pas lire par-dessus son épaule, ces mots où elle décrivait des instants de la vie d’une femme et je me demandais si elle parlait de la sienne.
Elle enchaînait les pages faisant de toutes ses feuilles, qu’elle entassait à l’arrière de son carnet, ses partitions. Sa musique des mots me semblait douce à l’oreille rien qu’à la regarder assise sur sa banquette. De sa voix, que je n’avais jamais entendue, j’aurais voulu qu’elle me lise ces instants, qu’elle me fasse découvrir son œuvre, afin que je puisse, comme étant enfant croire en l’innocence des mots d’adulte.
Elle usait les stylos les uns après les autres, et j’en découvrais régulièrement de nouveau design et de nouvelle courbe, dévorant les siennes des yeux. J’aurais voulu les décrire de mes propres mains avec mes propres mots. Mais elle me semblait si douce que j’avais peur de la salir des lignes de ma main et qu’inconsciemment, je ne me rapprochais jamais d’elle, mais m’en éloignais toujours davantage. Quel pêché avais-je donc commis pour ne pouvoir que la lire de loin sans jamais pouvoir tourner les pages du livre de sa vie.
Souvent, je me disais que son inspiration devait lui venir d’un autre monde. Car elle ne cessait d’écrire, à toute vitesse, des mots qui se suivaient les uns aux autres avant même qu’elle n’ait eu le temps d’écrire le précédent. Je me demandais par quelle magie, elle pouvait ainsi attirer à elle, tous ces mots et former des phrases. Je me demandais à quoi ils pouvaient bien lui servir et s’il avait une autre signification à ses yeux. Si, entre les lignes d’autres mots venaient s’écrire à l’encre invisible. De ce fait, je me demandais qu’elle était son métier pour qu’elle soit ainsi si inspirée, où était-ce simplement la vie qui l’inspirait.
Parfois, un mot s’échappait et venait danser devant mes yeux. Ils étaient faits d’amour, et parfois, il me faisait verser une larme, ils étaient drôles et si durs à la fois. Je me demandais si ses propres mots la touchaient où s’ils n’étaient que des compagnons de train. Je me demandais ce qu’elle vivait pour écrire ainsi une vie si opposée, l’une à l’autre, ce qu’elle cherchait et ce qu’il manquait à sa vie pour ne plus en faire que des rires et oublier les larmes que ses mains versaient sur le papier.
C’est pourquoi, je me demandais si quelqu’un partageait sa vie, si quelque part quelqu’un l’aimait. Et si finalement, elle n’écrivait pas de longues lettres d’amour, à quelqu’un qui était séparé d’elle par les kilomètres. Je ne le savais pas et elle ne m’aidait pas à le deviner. Sur sa banquette, elle restait silencieuse de sa voix, mais ses mains continuaient de parler dans un débit qui me semblait fou.
Le train avait démarré depuis longtemps, lorsque je finissais par m’en rendre compte. J’étais assis à côté d’elle, et pourtant elle me manquait déjà. J’allais passer la nuit, à imaginer notre rencontre du lendemain, identique à celle de tous les autres jours. La locomotive se balançait sur les rails, la faisant sauter de tout son corps sur la banquette défoncée par les années. Mais même les cris de cet animal, fait de fer, ne semblaient pas, le moins du monde, la perturber dans son travail.
Quelquefois, je m’essayais tout contre elle, quand le nombre de passagers me le permettait. Je sentais son parfum doux et sucré, qui réveillait, dans mes narines, une enivrante douceur qui coulait entre mes veines. Je me délectais de la chaleur de son corps contre le mien. Mais elle était ingrate et n’avait d’yeux que pour sa plume et sa feuille qui se remplissait rapidement sous mes yeux ébahis de tant de choses à dire.
Je voyais, que je ne l’intéressais guère et qu’elle ne jetait sur moi aucun regard. Savait-elle seulement que j’existais et que j’étais là près d’elle, espérant qu’elle fasse un seul geste vers moi. Je la voyais barrer des mots, les remplacer par d’autres, comme elle m’avait enlevé de sa vie avant même que je puisse y entrer.
Je m’imaginais que ce devait être une romantique. Moi, je n’étais qu’un pauvre mal imaginant ses doigts sur mon corps comme si j’étais une feuille, sa feuille. Et qu’enfin, elle écrirait sur moi, avec ses lèvres, une histoire faite d’amour, comme elle le faisait avec ses doigts, sur le papier. Celui-là même, qu’elle tenait de ses doigts tachés par l’encre bleue de son stylo à plume et qu’elle tenait ce soir, entre ses mains. Je rêvais qu’elle m’écrivait une histoire et me la chuchotait au creux de l’oreille. Une histoire qui n’aurait jamais de fin.
Mais je n’étais rien comparé à ce monde immense dans lequel elle vivait et où elle voyageait par la pensée, s’éloignant de moi, à chaque minute, à chaque mot. Ce monde la rendait égoïste et de plus en plus inaccessible, à mes yeux. J’aurais voulu détruire ses murs qui l’enfermaient, et qui, peut-être, l’écrasaient de leur poids et la cloîtraient dans son monde afin de mieux se protéger ou se cacher de l’extérieur. Peut-être avait-elle peur du monde, dans lequel son corps vivait. Mais je ne pouvais qu’émettre des suppositions, car elle ne m’aidait pas à répondre aux questions que je me posais à son sujet.
Les yeux plissés, les sourcils froncés, elle continuait d’écrire me laissant seul sur cette banquette froide. Ses cheveux glissaient de derrière ses oreilles, cachant son visage, et je me perdais dans les reflets que la lumière faisait danser dans cet écran soyeux.
Au fond de moi, je continuais d’espérer qu’un soir enfin elle me regarderait, avec les mêmes yeux amoureux que j’avais pour elle. Qu’un soir enfin, elle prendrait conscience qu’elle respirait le même air que le mien et que l’on pourrait partager bien plus qu’une banquette orange. Je me demandais, lorsqu’elle descendait du train, qui la regardait écrire de ses mains douces qui tremblaient parfois.
Et puis un soir, sur un petit papier qu’elle laissa en quittant la banquette en quittant sa banquette, elle m’avait écrit les mots qui ont scellé notre vie : « Je crois que je vous aime ». Ces quelques mots, elle me l’avoua bien des années plus tard, elle les avait écrits, pour moi, à l’encre de son cœur.